L’aide alimentaire concernerait 600 000 personnes en Belgique. La crise du Covid n’a fait que renforcer leur nombre, mais les a aussi rendues visibles, obligées de faire la file dans la rue. Derrière les comptoirs des associations, ce sont des milliers de bénévoles ou salariés des services sociaux qui se démènent chaque jour pour récolter toujours plus de vivres – pour beaucoup des invendus de l’industrie agroalimentaire, de la grande distribution ou de petits commerces. Un système qui tourne à plein régime.
Les invendus à l’aide (alimentaire)

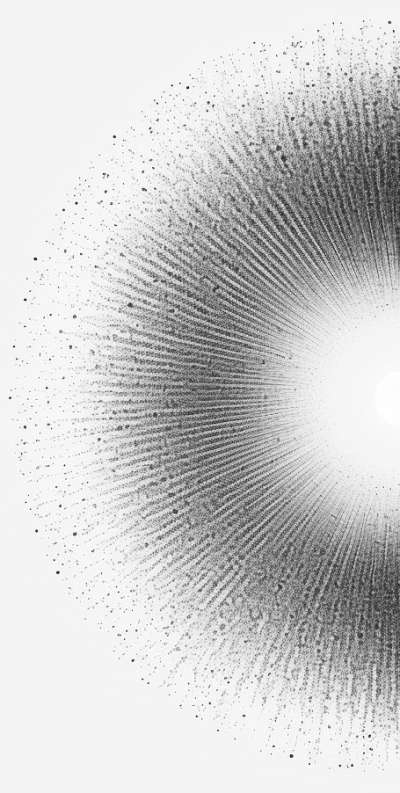 Skip to the content
Skip to the content




