Les Samis, dernier peuple autochtone d’Europe, vivent sous les latitudes polaires depuis la dernière période glaciaire. Pris en étau entre le dérèglement climatique et les investissements verts pour le tempérer, leurs hivers et leurs paysages se métamorphosent. Autant de changements déboussolant une culture multi-millénaire. La Laponie, dite Sápmi, est devenue un lieu où l’on expérimente la solastalgie : le mal du pays quand on est chez soi. Reportage.
L’érosion culturelle du peuple Sami

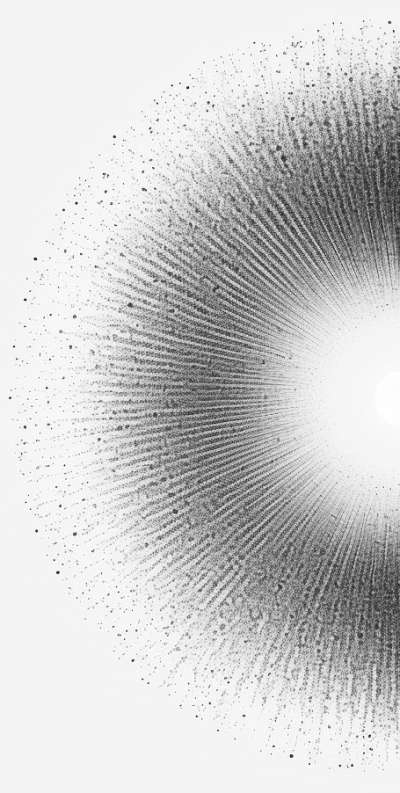 Skip to the content
Skip to the content











