Chaque année, à l’automne, la saison de migration des oiseaux est synonyme de braconnage. La tenderie, une technique de chasse consistant à piéger des oiseaux, est pourtant interdite depuis 1993. Les moyens de l’Unité anti-braconnage wallonne pour lutter contre cette prédation semblent trop faibles. Ce qui n’est pas sans poser question, à l’heure où les populations d’oiseaux s’effondrent. C'est le premier épisode d'une série portant sur la délinquance environnementale, signée Sarah Freres.
Le silence des oiseaux

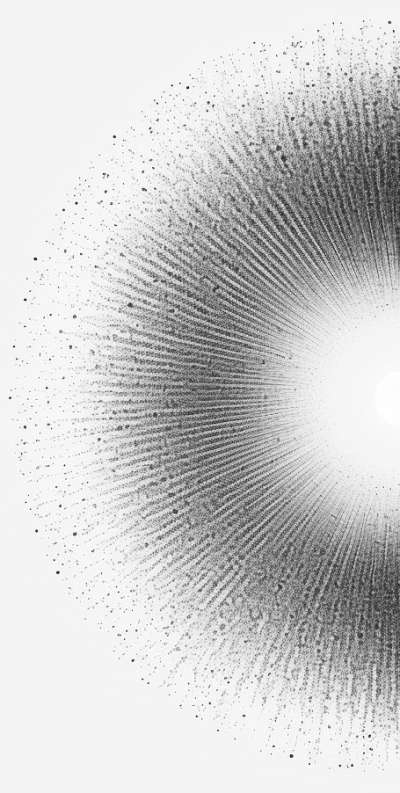 Skip to the content
Skip to the content




