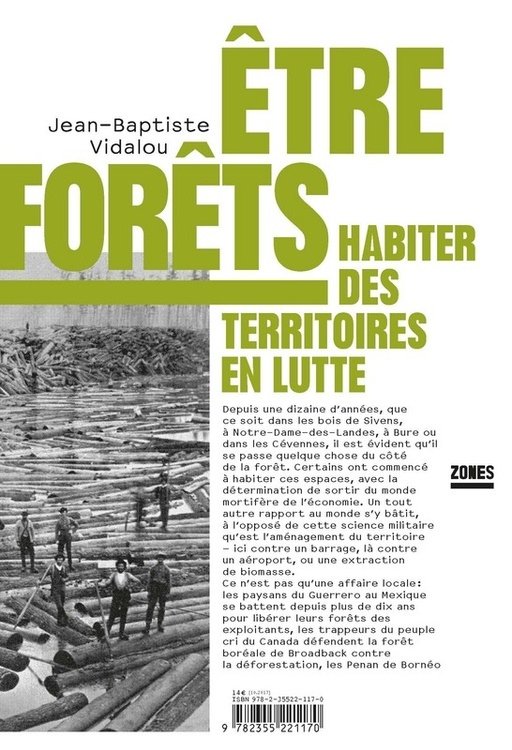La forêt a-t-elle toujours été un lieu refuge ?
— De tous temps, elle a effectivement été habitée par ceux qu’on appelle des « rebelles ». Pendant le Moyen-Âge par exemple, les gens qui cherchaient à fuir le pouvoir centralisateur de l’Eglise vivaient dans les forêts, beaucoup plus étendues bien sûr que maintenant. Des communautés y habitaient, en marge de la société, tout en maintenant des liens avec les villages. C’étaient des zones de non-droit, où les gens pouvaient aller et venir, rester un moment, ou s’installer à vie, comme les ascètes.
Vous racontez notamment l’histoire de la Guerre des Demoiselles, qui a eu lieu dans l’Ariège au 19e siècle… C’est d’un de ses acteurs que vient votre nom de plume d’ailleurs.
— C’est l’une des dernières révoltes populaires, paysannes. Ces gens, qui vivaient dans leur montagne, ont réussi à résister au pouvoir centralisateur de Colbert. Lui avait besoin d’énormes quantités de bois, il voulait rationaliser les forêts de France, interdire leur usage « commun ». Les habitants allaient y glaner du petit bois, y cueillaient des végétaux, y faisaient pâturer leurs troupeaux, toutes choses dorénavant interdites. Ils se sont révoltés en jouant des rituels traditionnels populaires du carnaval, des charivaris : les jeunes garçons se déguisaient en femmes ou se noircissaient le visage avec du charbon avant d’attaquer les gendarmes, les charbonniers [accusés d’exploiter le bois, ndlr], les gardes forestiers. Même s’ils usaient de la violence, il n’y eut jamais de mort. Ils faisaient des allers-retours entre les villages et la forêt, utilisaient le symbole du carnaval – mettre le monde à l’envers – comme pouvoir opérant.
« Nous avons tous en tête des histoires de Petit Chaperon rouge ou de Robin des Bois »
Les bois étaient des biens « communaux » par excellence ?
— Les forêts ont toujours été des endroits au sein desquels les communautés pouvaient tirer des richesses, même si elles ne leur appartenaient pas en propre. Ce sont des zones hybrides, des donations des églises et des suzerains, des assemblages flous où les pouvoirs en place ont toujours du mal à légiférer. Aujourd’hui, même s’il reste encore des traces de ces communaux, les modes de vie ont changé, ils sont souvent abandonnés à l’état de potentialité. Mais ils se retrouvent dans des zones comme les ZAD, à Notre-Dame-des-Landes (Nantes), à Bure (Grand Est) – occupés, d’un côté, par des activistes qui s’opposent à la construction d’un aéroport et, de l’autre à l’enfouissement de déchets nucléaires –, où à d’autres endroits où il n’y a pas nécessairement de confrontation mais où cet imaginaire communal se redéploie, où les gens s’organisent entre eux pour raviver ce lien intrinsèque entre les habitants et le lieu où ils habitent. Ce sont Isabelle Stengers ou Bruno Latour qui développent cette idée intéressante de penser plutôt la liberté en termes d’attachement et non de détachement. Plus nous serons attachés aux lieux, aux êtres humains et aux non-humains qui nous entourent, plus nous aurons une chance de trouver une porte de sortie aux problèmes globaux.
La forêt tient une place particulière dans notre imaginaire…
— Nous avons tous en tête des histoires de Petit Chaperon rouge ou de Robin des Bois. Et pour peu que l’on ait habité pas trop loin d’un bois, on y a sans doute passé des heures à construire des cabanes, à se cacher. C’est inscrit dans la mémoire collective de la plupart des peuples. Il y a quelque chose de magique là-dedans, mais cette magie se construit par ailleurs : il peut y avoir des « forêts », des zones d’opacité de ce type dans les villes ou les déserts. Ernst Jünger, par ailleurs auteur plutôt réactionnaire, disait que de la forêt1, il y en a partout, c’est une disposition existentielle à la fuite et à la contre-attaque. Certains théoriciens américains de la contre-insurrection parlent de zones urbaines, de la banlieue française comme d’une forêt, des lieux opaques, touffus, où l’on ne peut pas aller comme on veut.
Le pouvoir a toujours cherché à supprimer ces zones, à les « mettre en coupe » ?
— Il y a eu de tout temps une forte pression des grands empires sur la forêt. Depuis les Grecs et les Romains existe cette volonté d’éradiquer toutes les zones d’opacité d’où pouvaient sortir les révoltes. Le pourtour méditerranéen tel que nous le connaissons aujourd’hui, plutôt pelé, a en fait été ravagé à l’époque, les bois coupés pour construire les villes et des bateaux. Bien sûr, à certains moments les communautés paysannes, elles aussi, ont exercé une forme de pression sur l’environnement, en prélevant de plus en plus de bois pour se chauffer. Mais à un moment l’Etat a dit clairement _« La forêt est à nous, et nous l’exploitons ». Et plante des résineux, crée des champs d’arbres en quelque sorte…
Certaines zones sont tout de même préservées, des réserves naturelles sont créées. Pas d’une bonne manière ?
— Oui, certaines parties sont exploitées et puis d’autres sont conservées. Mais ces dernières sont mises sous cloche, ce sont des espaces stratégiques, avec un attrait touristique, des dividendes à la clé. Aux USA, le premier parc créé, le Yellowstone, l’a été avec l’expulsion des Indiens qui y vivaient. La nature « conservée » est perçue comme un objet séparé, où la présence humaine n’est pas possible. En France, ce sont des endroits très réglementés, découpés en zones, avec une forte hiérarchie administrative. C’est comme si aucun espace ne pouvait échapper au système, comme si tous les territoires un peu opaques devaient recevoir la « lumière » gouvernementale. Mais à présent, même là, l’exploitation devient autorisée : l’entreprise E.ON vient puiser dans le parc des Cévennes pour alimenter sa centrale en bois-énergie.
Vous dénoncez dans votre ouvrage une vision « d’ingénieur ». Qu’entendez-vous par là ?
— Un ingénieur forestier va voir les mètres cubes de bois, un plan de gestion, tout ce qu’on lui a appris à l’école. Il est perçu comme le mieux à même de calculer, de réduire la multiplicité à des lignes de chiffres. C’est une vision du réel terriblement réductrice. Cette figure de l’ingénieur est encore largement hégémonique dans notre perception du monde. Mais elle ne fonctionne pas ! J’entendais un membre d’un bureau d’étude dire qu’il avait renoncé à calculer la compensation carbone d’une forêt : la quantité de carbone n’est pas la même si l’arbre est sur pied, au sol, en train de pourrir, selon l’espèce, selon le lieu, la période de l’année. C’est une vue de l’esprit que de mesurer le carbone de façon égale partout. C’est tenter de rendre équivalent ce qui ne l’est pas, comparable ce qui est incomparable. Ceci dit, les lignes bougent. Peu à peu d’autres façons de voir la forêt progressent : on se rend compte qu’elle n’est pas un arbre plus un arbre plus un arbre, mais que ces derniers communiquent entre eux, se défendent collectivement contre des parasites, vivent en symbiose, etc. Il y a aussi des collectifs, comme le Réseau pour les alternatives forestières, qui travaillent en ayant le moins d’impact possible, avec le débardage animal, sans pratiquer de coupes rases et en privilégiant les feuillus. Ils voient la forêt dans toute sa richesse. Cette question dépasse celle de la forêt. Il s’agit de regarder notre monde au ras du sol et non depuis des satellites et des avions. Le changement climatique est une affaire globale mais ce n’est pas avec le prisme du calcul managérial que nous pourrons le saisir, bien par un retour sur terre... – Propos recueillis par Laure de Hesselle

 Skip to the content
Skip to the content